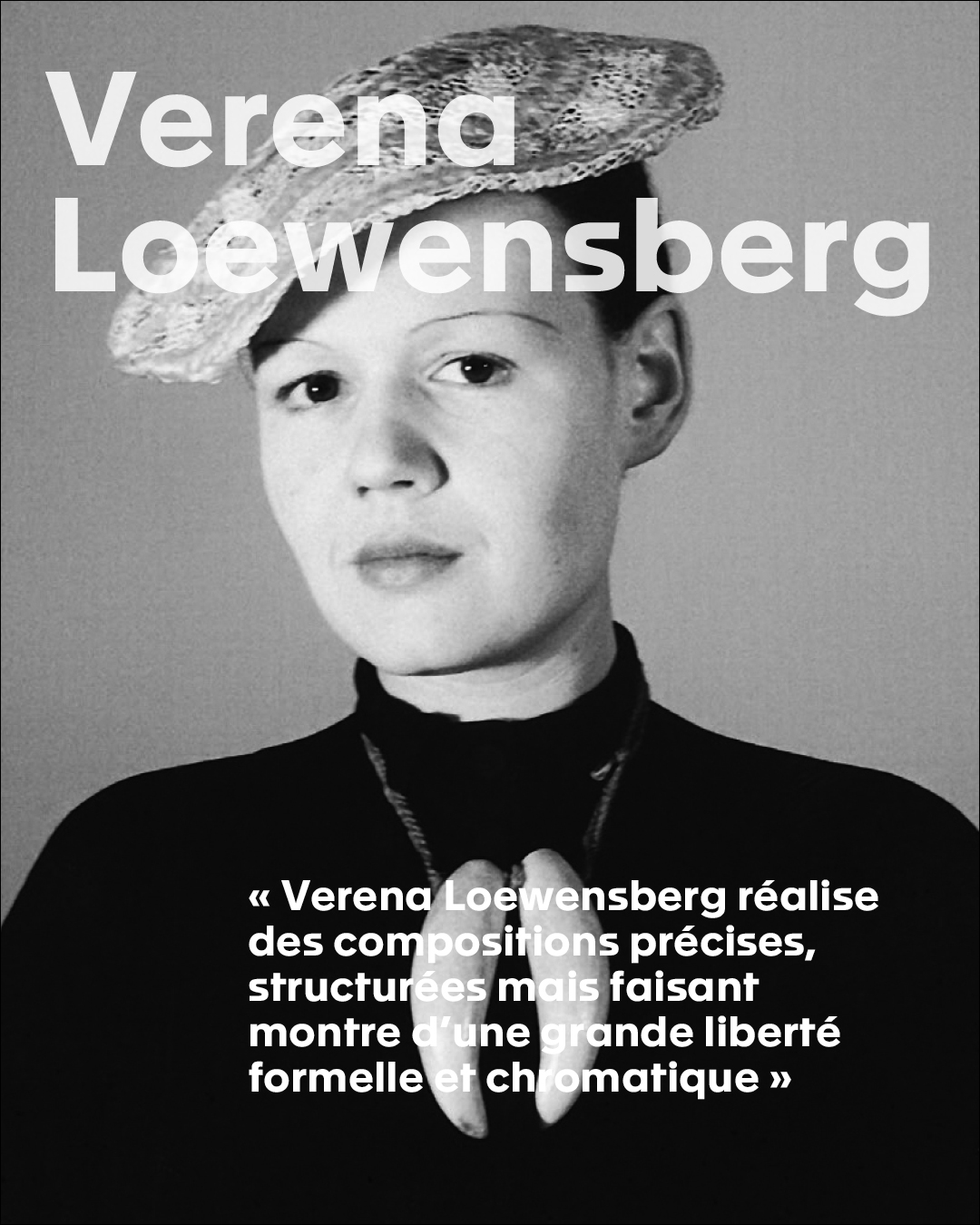Une récente rétrospective au Mamco de Genève invitait à redécouvrir le travail de Verena Loewensberg (1912-1986), la seule femme du groupe des «concrets zurichois» (avec Max Bill, Camille Graeser et Richard Paul Lohse).
Dernier mouvement moderne en Suisse, l’art concret domine la scène nationale jusqu’à la fin des années 1960, lorsque d’autres influences internationales surgissent et finissent par l’éclipser. Apparu dans l’entre-deux-guerres en Europe, l’art concret construit son langage à partir de la seule utilisation d’éléments plastiques – formes, surfaces, couleurs – pour servir un principe géométrique clair. Ces orientations s’inscrivent dans un projet social qui renouvelle les idées du Bauhaus, tout comme celles du constructivisme et du productivisme russes ou encore de «l’unisme» en Pologne. Les principes de l’art concret peuvent en effet être appliqués à d’autres domaines, à l’instar de la typographie, de l’architecture et du design. Car il s’agit, ainsi que l’écrivait Serge Lemoine, de «réaliser un art mesurable, valable pour tous, avec des formes qui pourront s’adapter à toutes les situations, être comprises de tous les publics, afin de créer un langage universel, identique à celui de la science ou de la musique».

Unique femme du groupe des «concrets zurichois» (avec Max Bill, Camille Graeser et Richard Paul Lohse), Verena Loewensberg n’atteint la même reconnaissance que ses compagnons qu’après l’apogée du mouvement. Il faudra en effet attendre la rétrospective du Kunsthaus de Zurich en 1981 (la première d’une artiste femme organisée par ce musée), cinq ans avant sa disparition, pour découvrir toute l’étendue de sa pratique.
Verena Loewensberg, née en 1912, réalise des compositions précises, structurées mais faisant montre d’une grande liberté formelle et chromatique. Ses premières œuvres remontent à 1936 et la première peinture enregistrée dans son catalogue raisonné (qui compte près de 630 toiles, ainsi que des gouaches, des dessins, des gravures et une sculpture) date de 1944.
Après des études à la Gewerbeschule de Bâle (école des arts et métiers) où elle suit une formation en dessin, textile et théorie des couleurs, elle prend des cours de danse à Zurich. Entrée en contact, par l’intermédiaire de Max Bill, avec le groupe Abstraction-Création, qui gravite à Paris autour de Georges Vantongerloo, elle participe avec celui-ci à sa première exposition.
Dans les décennies qui suivent, mariée, jusqu’en 1949, au designer Hans Coray, elle développe sa pratique picturale, tout en travaillant pour l’industrie textile locale et en se consacrant à des commandes d’art appliqué. Passionnée de jazz, elle ouvre, dans les années 1960, un magasin de disques à Zurich (City-Discount), qui deviendra rapidement un lieu de référence pour tous les amateurs de musique. Dès cette époque, son travail repose sur des formes et des séries qui s’éloignent du canon de l’art concret et la rapprochent d’expériences menées au sein du color-field painting, du pop art ou de l’art minimal aux Etats-Unis.

La rétrospective que lui consacrait le Mamco en 2022 était structurée autour de cette évolution: partant du rapport que toute cette génération entretenait au motif de la grille en tant que système d’organisation rationnel, elle en montrait «l’explosion» dès les années 1950, tout en rappelant l’importance de la musique et des arts appliqués dans les premières compositions de l’artiste. Elle montrait aussi cette libération des formes et des couleurs qui aboutit aux séries des années 1970 et 1980, lesquelles dialoguent avec la pratique de la sérialité et l’abstraction radicale dont elles sont contemporaines.
Ce parti pris «curatorial» distinguait ce projet des rétrospectives précédentes consacrées à l’artiste, par l’Aargauer Kunsthaus en 1992, par Haus Konstruktiv à Zurich en 1998 ou le Kunst Museum Winterthur en 2012. Le milieu de l’art suisse a bien pris note de cette différence d’approche: l’exposition a suscité de nombreuses réactions, tant sur le plan de la presse suisse alémanique que de la perception du travail de Loewensberg auprès des professionnels du domaine muséal et des galeries.
En ce sens, l’exposition prenait place dans une série de projets qui, à l’instar de Max Bill Global du Zentrum Paul Klee ou de la rétrospective consacrée à Geraldo de Barros au Mamco, venaient questionner l’historiographie de l’art concret et revendiquer une réévaluation de certains de ses aspects. Car le succès de ce mouvement en Suisse est également responsable de son rejet par une génération d’historiens et d’historiennes de l’art qui émerge à la fin des années 1960; il fallait sans doute qu’une génération postérieure s’en empare pour renouveler certains axes de lecture…
Pour beaucoup d’amateurs d’art et de visiteurs du musée, ce fut plus simplement une découverte: peu connue dans les régions francophones et s’étant rarement exprimée sur son travail, Verena Loewensberg était révélée pour ses immenses qualités de coloriste, la précision de ses gestes picturaux, la versatilité de ses compositions et l’amplitude de ses recherches. Les deux dernières séries sur lesquelles elle travailla entre les années 1970 et son décès, un système de divisions horizontales du tableau et de carrés dans un format carré, disposant chacune d’une salle propre, créaient la surprise et soulignaient la singularité de cette artiste au sein d’une génération de peintres concrets.
Verena Loewensberg a fait récemment l’objet d’expositions à New York et à Londres, à la Galerie Hauser & Wirth. Dans les deux cas, il s’agissait de premières expositions monographiques dans ces pays
- Le Musée d’art moderne et contemporain de Genève (MAMCO) va vivre hors de ses murs, le temps, d’ici à 2028, que le bâtiment qui l'accueille soit rénové. En attendant sa mise aux normes énergétiques et l'installation du contrôle climatique, le MAMCO produira, à l’initiative de partenaires, des projets hors-site dans des lieux inédits. «Le Temps» est l'un des ces lieux